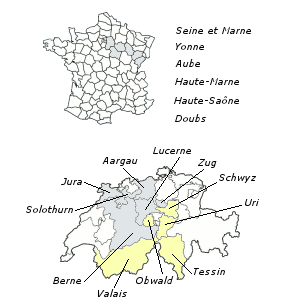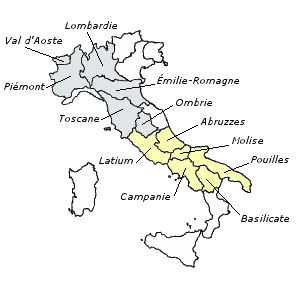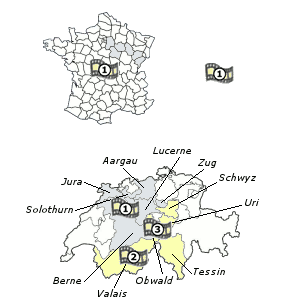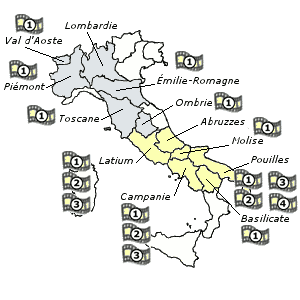Le récit épistolaire du président de Brosses

Le président de Brosses
Charles de Brosses, né en 1709, fut magistrat, historien et linguiste. Avant de devenir « président à mortier » au parlement de Bourgogne - l’une des charges les plus importantes de la justice française de l’Ancien Régime -, celui qu’on ne connut plus désormais que sous le nom de « Président de Brosses » effectua un long périple en Italie en 1739 et 1740.
Dix ans après son retour, il publia ses Lettres d’Italie, qui constituent l’archétype d’une forme particulière de relation de voyage : le recueil de lettres envoyées par l’auteur à ses amis ou à sa famille pendant son séjour. Ni vraies lettres ni vrais journaux, il s’agit le plus souvent de récits factices, écrits a posteriori et fondés sur des souvenirs travaillés et enjolivés.
Précautions oratoires
J’aimerais mieux, je crois, vous faire quatre fois la description de tout le reste de l’Italie qu’une seule fois celle de Rome. Elle est belle cette Rome, et si belle que, ma foi, tout le reste me paraît peu de chose en comparaison. […] Après tout, que pourrais–je vous dire sur cette matière qui ne fût un rabâchage perpétuel ? Cette ville a été tant vue, tant décrite ; il y a tant de plans, tant de figures ; qu’il ne tient qu’à vous de faire, comme madame Houdart, un voyage sédentaire dans votre cabinet. ![]()
Impressions de la basilique Saint–Pierre de Rome
Quelle impression croyez–vous que vous fera le premier coup d’œil de Saint–Pierre ? Aucune. Rien ne m’a tant surpris à la vue de la plus belle chose qu’il y ait dans l’univers que de n’avoir aucune surprise ; on entre dans ce bâtiment dont on s’est fait une si vaste idée, cela est tout simple. Il ne paraît ni grand, ni petit, ni haut, ni bas, ni large, ni étroit. On ne s’aperçoit de son énorme étendue que par relation, lorsqu’en considérant une chapelle, on la trouve grande comme une cathédrale ; lorsqu’en mesurant un marmouset qui est là au pied d’une colonne, on lui trouve le pouce gros comme le poignet.
Tout cet édifice, par l’admirable justesse de ses proportions, a la propriété de réduire les choses démesurées à leur juste valeur. Si ce bâtiment ne fait aucun fracas dans l’esprit à la première inspection, c’est qu’il a cette excellente singularité de ne se faire distinguer par aucune. Tout y est simple, naturel, auguste, et par conséquent sublime. Le dôme, qui est à mon avis la plus belle partie, est le Panthéon tout entier, que Michel–Ange a posé là, en l’air, tout brandi de pied en cap. La partie supérieure du temple, je veux dire les toits, est ce qui étonne le plus, parce qu’on ne s’attend pas à trouver là–haut une quantité d’ateliers, de halles, de coupoles, de logements habités, de campaniles, de colonnades, etc., qui forment, en vérité, une espèce de petite ville fort plaisante. La moindre partie de l’église, à ce que je trouve, est le portail ; ni celui–là, ni celui qu’on vient de faire à Saint–Jean–de–Latran, quoique assez beau l’un et l’autre, ne répondent à la majesté des bâtiments. Comment ceci a–t–il pu être construit par des gens qui avaient devant leurs yeux la façade de la Curia Antoniana et celle du Panthéon ? ![]()
À Rome, tout est de palais ou de cabanes
[Piazza del Popolo,] regardez toujours vis–à–vis de vous, sans vous aviser de jeter les yeux sur les côtés du triangle ; vous ne verriez à droite que de grands vilains magasins à foin ; à gauche, que l’église Sainte–Marie, assez médiocre bâtiment, suivi de plusieurs maisons particulières très piètres ; de sorte que la place del Popolo, quoiqu’elle contienne plusieurs belles choses, n’est nullement une belle place.
C’est un défaut assez général ici qu’une telle disparité ; tout est de palais ou de cabanes ; un bâtiment superbe est entouré de cent mauvaises maisonnettes ; quelques grandes rues principales, d’une longueur sans fin, alignées à merveille, presque toujours terminées par de beaux points de vue, servent heureusement à se retrouver, au milieu d’une foule de culs–de–sac, de ruelles tortueuses ou de mauvais petits carrefours. Il n’y a rien de plus aisé que de savoir la ville en gros, et rien de si difficile que de s’en démêler en détail. Je croirais volontiers que Rome se ressent encore d’avoir été brûlée par les Gaulois et de ce que, en la rebâtissant, chaque habitant édifia sans ordre et sans suite, dans la première place qu’il avait trouvée vacante. ![]()
(Le Président de Brosses en Italie, Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740, Éd. Didier, 1858)
Texte complet disponible sur le site de la BNF : ![]()
Ajouter à mes favoris Recommander ce site par mail Haut de page
Cet article vous a plu, ou vous appréciez ce site : dites-le en cliquant ci-contre sur le bouton "Suivre la page" : |